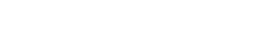L’hydrographie moderne et l’apport des véhicules sous-marins autonomes (AUVs)
Résumé
L’hydrographie est la discipline visant à la mesure et à la description des caractéristiques physiques des océans, mers, lacs et cours d’eau. L’objectif principal est la caractérisation et la mesure du fond, de manière à cartographier les étendues navigables et leurs potentiels dangers. Traditionnellement orientée vers la sécurité maritime et la cartographie nautique, l’hydrographie s’est progressivement élargie pour inclure l’étude des environnements marins, l’exploration et la gestion des ressources, la prévention des risques naturels et le soutien aux activités économiques offshore. L’évolution rapide des technologies acoustiques, géospatiales et numériques a transformé cette science, la rendant plus précise, rapide et intégrée. L’arrivée des robots et notamment des véhicules sous-marins autonomes (AUVs) marque une rupture technologique majeure dans la manière dont les données hydrographiques sont acquises.
Grâce à leur autonomie, leur précision et leur capacité à intervenir dans des environnements complexes, les AUVs s’imposent comme des outils incontournables pour l’hydrographie du XXIe siècle.
Cet article présente les fondements de l’hydrographie, ses méthodes, ses principaux outils, ses domaines d’application et les perspectives qu’elle ouvre pour le XXIe siècle. Il propose également une synthèse des apports des AUVs, de leurs limites, et de leurs perspectives d’évolution.
1.Introduction
L’hydrographie occupe une place stratégique dans l’histoire maritime et continue d’être une discipline clé pour les États, les scientifiques et les acteurs industriels.
Depuis les premières cartes marines rudimentaires jusqu’aux modèles numériques 3D actuels, l’hydrographie a évolué au rythme des progrès technologiques. Elle répond aujourd’hui à des enjeux multiples : sécurité de la navigation, cartographie des fonds, inspections de structures immergées, protection de l’environnement marin, suivi de travaux en mer (dragage, constructions…) exploitation des ressources, anticipation des risques naturels et appui aux opérations militaires.
L’hydrographie, branche appliquée des sciences géophysiques et océanographiques, s’intéresse à la mesure et à la description des fonds marins et des caractéristiques physiques des milieux aquatiques. Cette dicipline a largement évolué au fil des siècles depuis la mesure manuelle de la hauteur d’eau depuis le fond avec un fil à plomb et le report de la mesure appelée “sonde” sur une carte jusqu’à l’utilisation couplée de sondeurs multifaisceaux haute résolution, GPS, centrales inertielles. Traditionnellement menée depuis des navires dotés d’équipements acoustiques, cette discipline est aujourd’hui en pleine mutation grâce à l’émergence des drones, notamment les drones sous-marins autonomes appelés AUVs (Autonomous Underwater Vehicule).
Le recours croissant à ces plateformes innovantes permet de surmonter de nombreuses limites des méthodes classiques, tout en ouvrant de nouveaux champs d’application. Cet article explore les fondements de l’hydrographie moderne et met en lumière les apports et défis associés à l’utilisation des AUVs.
2.Fondements de l’hydrographie
2.1 Histoire de l’hydrographie
Traditionnellement, la navigation des navires sur les océans se faisait en gardant la côte à portée de vue. En 1187, l’invention du compas magnétique et son utilisation avec des cartes marines a révolutionné les itinéraires et la navigation en pleine mer. Ces cartes étaient à l’origine dessinées à la main à partir des observations des marins pendant la navigation. La représentation plane nécessitant des projections des observations magnétiques a également rendu plus précises les méthodes de cartographie. Ainsi les cartes établies permettaient d’établir et de suivre des routes. Ces cartes étaient donc gardées précieusement afin d’assurer un avantage économique et militaires à ceux qui les possédaient. Les voyages et le commerce transocéanique a alors pu se développer et des cartographies et des levés hydrographiques ont été commandés afin d’assurer la sécurité de la navigation. Ces informations stratégiques ont ensuite fait l’objet de campagnes de levés commandés par les états et les puissances économiques.
Les techniques ont évolué depuis les relevés de position au compas magnétique avec une mesure des sondes au fil à plomb. L’avènement de l’électronique embarquée, la conquête spatiale et l’élaboration de technologies de pointe en acoustique ont mené à l’utilisation de capteurs toujours plus précis et donc à l’exploration plus fine des fonds marins aujourd’hui.
2.2 Objectifs principaux
L’hydrographie vise à décrire la morphologie des fonds marins via la mesure de sondes (mesure de la hauteur d’eau par rapport à un point de référence en altitude, le zéro hydrographique). Ces sondes sont déterminées à des coordonnées horizontales, ce qu’on appelle le positionnement. Cette mesure appelée bathymétrie, permet de cartographier en reportant la profondeur du fond marin sur une carte. Ce sont ces mesures qui permettent de créer les cartes marines et ainsi de sécuriser le trafic maritime, notamment près des côtes. L’hydrographie s’intéresse également à la nature du fond, à savoir s’il se compose de sable, de gravier ou de roches, s’il comporte des rides, des dunes ou des obstacles comme des épaves. Ces caractéristiques permettent de cartographier des habitats écologiques par exemple comme des herbiers ou des champs de vase.
Les équipements acoustiques dits de sismique peuvent également permettre d’imager le sous- sol du fond marin sous forme de profils. Ces derniers permettent d’établir des modèles 3D des couches géologiques sédimentaires ou rocheuses sous le fond. Des données de magnétométrie peuvent également être collectées afin de caractériser les anomalies magnétiques du fond marin et d’étoffer encore les connaissance du fond.
D’autres données sont monitorées par les activités hydrographiques comme les paramètres océanographiques à savoir la température, la salinité, les courants. La mesure des marées est également une partie importante de l’hydrographie, permettant de prévoir les hauteurs d’eau aux endroits de navigation en fonction de la marée prévue.
Ces différentes mesures permettent la cartographie de différentes informations ayant des implications dans divers domaines comme la navigation, l’exploration, la gestion des ressources, la construction ou encore le domaine militaire. L’hydrographie permet donc d’acquérir des données géographiques et géophysiques sur les plans d’eau afin de produire des bases de données, des cartes marines et des modèles hydrographiques. Aujourd’hui, les cartes marines existent encore en papier mais compilent pour la plupart des informations numériques et sont utilisées dans la navigation marine, la représentation de données océanographiques, la modélisation.
Les données hydrographiques sont plus concrètement utilisées pour le dragage sous-marin.
Concrètement, l’hydrographie continue de fournir des données utilisées pour le dragage sous- marin, l’ancrage, la pose de pipelines, le câblage et la recherche d’épaves comme celle du Titanic. Il est important de noter que les données hydrographiques contribuent également à l’étude des organismes marins vivants et de leurs comportements via la cartographie des habitats et la collecte de données de qualité de l’eau. L’hydrographie contribue à la sécurité de la navigation de plaisance, de la navigation et du tourisme maritime, qui sont des piliers essentiels de nombreuses économies nationales. L’importance globale de l’hydrographie est difficile à quantifier en raison de la nature très variée des avantages économiques que les plans d’eau apportent aux gouvernements. En effet, tous les investissements économiques liés aux plans d’eau reposent sur l’hydrographie pour la compréhension du contexte, la gestion et l’utilisation future.
2.3 Normes et standards
L’Organisation Hydrographique Internationale (OHI/IHO) fixe les standards mondiaux (ex. S-44 pour les levés hydrographiques), garantissant la compatibilité et la qualité des données collectées.
L’ONU a commencé à soutenir les travaux de l’Organisation hydrographique internationale (OHI) en 1970 et lui a confié la mission de guider les organisations hydrographiques nationales et privées dans la réalisation de levés. Basée à Monaco, l’OHI compte actuellement 89 États membres. L’OHI veille à ce que toutes les eaux navigables fassent l’objet de levés et de cartes corrects. Cet organisme établit également les spécifications et les normes en matière d’hydrographie et de cartes marines. Parmi les membres de l’OHI figurent le Service hydrographique australien, le Service hydrographique naval argentin, le Service hydrographique canadien, l’Administration chinoise de la sécurité maritime (MSA), l’Office national cubain d’hydrographie et de géodésie, le Département hydrographique de la marine égyptienne (ENHD), le Service hydrographique et océanographique de la Marine nationale française, le Département hydrographique et océanographique japonais, le Service hydrographique néerlandais, l’Office hydrographique norvégien, le Département russe de navigation et d’océanographie, l’Office hydrographique du Royaume-Uni et l’Administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis (NOAA), qui abrite notamment l’Office of Coast Survey / National Ocean Service (OCS/NOS). La plupart des pays côtiers disposent de leurs propres organismes hydrographiques.
3.Méthodes et instruments
3.1 Technologies acoustiques
Les technologies acoustiques reposent sur l’émission et la réception d’ondes sonores dont les caractéristiques varient en fonction de l’objectif visé. Les sondeurs monofaisceaux (single beam echo sounder) utilisent généralement des fréquences comprises entre 12 et 200 kHz : les basses fréquences (12–33 kHz) permettent des mesures en grande profondeur, tandis que les hautes fréquences (jusqu’à 200 kHz) offrent une meilleure résolution mais sont limitées à des zones peu profondes. Les sondeurs multifaisceaux (multi beam echo sounderà émettent simultanément plusieurs centaines de faisceaux disposés en éventail, couvrant des angles allant de 120° à plus de 170°. Leur fréquence varie typiquement de 70 à 700 kHz selon la profondeur recherchée : les systèmes basse fréquence (70–100 kHz) permettent une exploration au-delà de 5 000 m, tandis que les systèmes haute fréquence (>300 kHz) produisent des modèles bathymétriques à résolution métrique voire décimétrique dans des zones côtières. Les sonars à balayage latéral (SSS) exploitent des fréquences comprises entre 100 et 1 200 kHz ; les basses fréquences (100–500 kHz) offrent une large couverture avec une résolution plus faible, tandis que les hautes fréquences (600–1 200 kHz) permettent de détecter des objets de petite taille (câbles, débris, structures biologiques) sur des portées plus réduites. Enfin, le sub bottom profiler (SBP) utilise des fréquences beaucoup plus basses, généralement de 1 à 15 kHz, ce qui lui permet de pénétrer les sédiments marins sur plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Les systèmes à impulsion courte (chirp) offrent une résolution verticale fine (décimétrique à subdécimétrique), tandis que les basses fréquences autorisent une imagerie plus profonde au détriment de la résolution.
Ces différentes technologies acoustiques présentent néanmoins des contraintes qu’il est important de prendre en compte lors de leur mise en œuvre. Les sondeurs monofaisceaux, bien que robustes et simples d’utilisation, ne fournissent qu’une information ponctuelle du fond marin et nécessitent donc un maillage dense de lignes de mesure pour produire une cartographie complète. Les sondeurs multifaisceaux, capables de couvrir de larges bandes du fond, exigent quant à eux des systèmes coûteux et complexes, ainsi qu’un étalonnage précis pour corriger les effets liés à la vitesse du son dans l’eau ou aux mouvements du navire. SBES et MBES partagent la même limitation en terme de résolution. Plus la zone sondée est profonde, plus le capteur se trouve loin du fond et donc plus la précision (et la résolution ou le maillage) tant horizontale que verticale est amplifiée. Les sonars à balayage latéral, s’ils offrent des images très détaillées, ne donnent pas directement la profondeur et doivent être interprétés avec soin, de plus leur performance est fortement dépendante de la nature du fond et de la rugosité des sédiments. Ils sont généralement tractés (“towfish”) ce qui représente une difficulté supplémentaire dans le déploiement du capteur lors de la collecte des données. Enfin, les sub-bottom profilers, essentiels pour l’étude de la stratigraphie des sédiments, souffrent d’une résolution limitée lorsqu’on recherche une pénétration importante, et leur efficacité peut être réduite dans les fonds très durs ou rocheux. Ainsi, chaque instrument répond à des besoins spécifiques, mais impose aussi des compromis entre profondeur d’exploration, résolution et conditions d’utilisation.
3.2 Technologies complémentaires
Les techniques de détection et de mesure en milieu marin reposent sur une diversité de capteurs complémentaires. Les magnétomètres sont utilisés pour repérer les anomalies du champ magnétique terrestre provoquées par la présence d’objets métalliques ferreux, ce qui les rend particulièrement efficaces pour localiser des épaves, des câbles ou encore des mines sous-marines. À côté de cela, les capteurs CTD (Conductivity, Temperature, Depth) constituent un outil fondamental de l’océanographie, puisqu’ils permettent de mesurer la conductivité – utilisée pour déterminer la salinité –, la température et la profondeur par pression, offrant ainsi une description précise de la structure physique de la colonne d’eau et des processus qui s’y déroulent. Enfin, le lidar bathymétrique aéroporté exploite un faisceau laser, généralement vert, émis depuis un avion ou un drone et réfléchi par le fond marin, afin de déterminer la profondeur dans les zones côtières peu profondes. Cette technique s’avère particulièrement précieuse dans les environnements où les navires hydrographiques ne peuvent pas évoluer et constitue un complément efficace aux méthodes acoustiques traditionnelles.
Chacune de ces techniques présente toutefois des limites qui conditionnent leur utilisation. Les magnétomètres, bien qu’efficaces pour la détection d’objets métalliques, ne peuvent repérer que les matériaux ferreux et sont sensibles aux perturbations magnétiques locales, ce qui peut compliquer l’interprétation des signaux. Les capteurs CTD, indispensables en océanographie, n’offrent qu’une mesure ponctuelle le long de la trajectoire de descente de la sonde et nécessitent souvent d’être multipliés ou combinés à d’autres instruments pour couvrir de vastes zones. De plus, leur déploiement est tributaire de campagnes en mer, parfois coûteuses et limitées par les conditions météorologiques. Quant au lidar bathymétrique aéroporté, s’il fournit des cartes rapides et détaillées des fonds peu profonds, sa portée est fortement réduite par la turbidité de l’eau et il reste inopérant au-delà de quelques dizaines de mètres de profondeur. En somme, ces technologies se complètent, mais chacune impose des contraintes techniques et environnementales qu’il faut prendre en compte pour planifier une mission d’exploration ou d’étude.
3.3 Plateformes d’acquisition
La mise en œuvre des technologies d’exploration sous-marine repose sur une variété de plateformes adaptées aux objectifs et aux environnements d’étude. Les navires hydrographiques spécialisés constituent la solution la plus complète, car ils permettent l’embarquement d’une large gamme d’instruments acoustiques et géophysiques, mais leur mobilisation entraîne des coûts logistiques élevés et une forte dépendance aux conditions météorologiques. Pour des opérations en zones côtières ou dans des environnements restreints, les bateaux légers et les drones de surface (USVs) offrent une alternative plus flexible et moins coûteuse, tout en permettant l’automatisation de certaines missions de cartographie. Les véhicules sous-marins – qu’ils soient téléopérés (ROVs) ou autonomes (AUVs) – permettent d’accéder directement au fond marin, d’effectuer des relevés de haute précision et, dans le cas des ROVs, de réaliser des interventions sur des structures ou objets détectés. Enfin, les avions et drones équipés de lidar bathymétriques constituent une
solution efficace pour la cartographie rapide de zones côtières peu profondes, là où les moyens navals sont limités. Néanmoins, qu’ils soient maritimes ou aéroportés, ces moyens restent contraints par des coûts d’acquisition et d’exploitation, des exigences techniques importantes et, dans le cas des plateformes navales, par la météorologie et l’accessibilité des zones étudiées.
Chaque type de plateforme présente des atouts spécifiques qui orientent leur emploi selon les besoins de la mission. Les navires hydrographiques spécialisés offrent la plus grande capacité d’emport en capteurs et en personnel scientifique, garantissant des relevés complets et une logistique adaptée aux longues campagnes océanographiques. En revanche, les bateaux légers et USVs se distinguent par leur flexibilité, leur coût réduit et leur aptitude à opérer dans des zones difficiles d’accès, ce qui en fait des outils privilégiés pour les relevés côtiers ou portuaires. Les AUVs permettent d’acquérir des données de très haute résolution en toute autonomie, y compris dans des environnements profonds ou dangereux, tandis que les ROVs ajoutent la capacité d’intervention directe sur le fond marin, ce qui les rend indispensables pour l’inspection d’infrastructures ou la récupération d’objets. De leur côté, les plateformes aéroportées équipées de lidar bathymétrique présentent l’avantage d’une acquisition rapide de données sur de vastes surfaces côtières, sans dépendre de la navigabilité locale. Ainsi, le choix de la plateforme dépend toujours d’un compromis entre la couverture spatiale, la résolution attendue, l’autonomie opérationnelle et les coûts mobilisés.
4.Applications de l’hydrographie
L’hydrographie joue un rôle essentiel dans de nombreux domaines, allant de la sécurité maritime à la défense en passant par l’environnement, l’économie et la gestion des risques.
4.1 Navigation et sécurité maritime
L’une des missions premières de l’hydrographie est d’assurer la sécurité de la navigation. Les levés hydrographiques permettent la production de cartes marines officielles par des organismes tels que la NOAA, le SHOM ou l’UKHO, indispensables à la circulation des navires de commerce et de défense. Ils contribuent également à la détection des dangers pour la navigation, qu’il s’agisse de hauts-fonds, de rochers ou encore d’épaves.
4.2 Environnement et climat
L’hydrographie constitue aussi un outil fondamental pour l’étude et la préservation des milieux marins. Les levés permettent le suivi de l’érosion côtière, la cartographie des récifs coraliens et la surveillance des habitats marins sensibles. Ils sont également mobilisés pour analyser les effets du changement climatique sur le littoral, comme la montée du niveau de la mer ou l’évolution des zones inondables.
4.3 Ressources et économie maritime
Sur le plan économique, l’hydrographie soutient la prospection et le développement des ressources marines, qu’il s’agisse de l’éolien offshore, du pétrole, du gaz ou des minerais sous-marins. Elle joue aussi un rôle stratégique dans la surveillance des infrastructures maritimes, en particulier les câbles de communication, les pipelines ou encore les digues et ports, dont la sécurité est essentielle pour le commerce international.
4.4 Risques naturels et catastrophes
Les techniques hydrographiques sont également utilisées pour la cartographie des zones à risques, par exemple celles susceptibles de connaître des glissements sous-marins ou des tsunamis. Elles interviennent aussi dans le suivi post-catastrophe, notamment après des séismes, des ouragans ou des inondations, afin d’évaluer les impacts sur les fonds marins, les côtes et les infrastructures.
4.5 Exploitation et recherche
L’hydrographie permet de cartographier de nombreuses zones en collectant de nombreuses données utiles pour la compréhension locale et globale du fonctionnement des océans. Elle compile des moyens utiles et précieux dans la constructions de modèles géophysiques et climatiques par exemple. C’est une branche à part entière de l’océanographie qui permet d’obtenir de plus en plus de données sur les océans, y compris des données sur des zones encore inexplorées ou peu connues.
4.6 Défense et géostratégie
Enfin, l’hydrographie revêt une dimension stratégique majeure dans le domaine militaire. Elle contribue à la détection des mines sous-marines, à la préparation des opérations navales et amphibies, ainsi qu’à la maîtrise de l’espace maritime dans un contexte géopolitique marqué par la compétition pour le contrôle des zones côtières et des ressources.
5.Défis actuels
Les campagnes hydrographiques sont caractérisées par un coût opérationnel élevé, en raison de la mobilisation de navires spécialisés, d’équipages qualifiés et de capteurs à forte valeur technologique (MBES, SBP, SSS). À l’échelle globale, la couverture bathymétrique demeure partielle : seulement ~25 % des fonds océaniques sont cartographiés avec une résolution répondant aux standards de l’Organisation Hydrographique Internationale (OHI). L’acquisition est en outre limitée par les conditions extrêmes : forte bathymétrie (>6 000 m), présence de glace dérivante, turbidité, ou contraintes géopolitiques dans certaines zones.
Enfin, l’hétérogénéité des formats de données et le manque d’interopérabilité entre systèmes freinent l’intégration dans des bases de données globales, ce qui complique leur exploitation en océanographie opérationnelle et en géosciences.
6.Perspectives d’avenir
Face à ces défis, les perspectives sont ambitieuses. Le programme Seabed 2030 vise à obtenir une cartographie complète des fonds océaniques d’ici 2030, grâce à la mutualisation des données et à la contribution de multiples acteurs. L’hybridation des plateformes, combinant navires, USVs, AUVs et drones aériens, permettra d’optimiser la couverture et de réduire les coûts. Parallèlement, l’intelligence artificielle offre de nouvelles solutions pour automatiser le traitement des données, améliorer la détection d’objets et affiner la classification des fonds. Le partage collaboratif via des plateformes mondiales telles que GEBCO ou EMODnet contribue déjà à démocratiser l’accès aux données marines. Enfin, le développement du jumeau numérique des océans, véritable modèle dynamique en temps réel, ouvre la voie à une gestion durable et intégrée des espaces maritimes.
7.Les véhicules sous-marins autonomes (AUVs)
Définition et fonctionnement
Un AUV (Autonomous Underwater Vehicle) est un vecteur sous-marin non habité capable de réaliser une mission prédéfinie sans liaison permanente avec un opérateur. Sa navigation combine :
- une centrale inertielle (INS) pour la trajectoire relative,
- un DVL (doppler velocity logger) pour la vitesse par rapport au fond,
- un USBL/LBL (Ultra/long Baseline) pour le recalage de la position (optionnel),
- des capteurs hydrographiques embarqués (MBES, SSS, SBP, CTD).
L’autonomie repose sur une planification de mission embarquée, avec possibilité de suivi adaptatif en fonction des données acquises. La navigation proche du fond (altitude < 50 m) garantit une résolution métrique à submétrique pour la cartographie.
8.Avantages des AUVs en hydrographie
Les AUVs constituent une solution privilégiée pour l’acquisition de données hydrographiques dans des environnements inaccessibles aux navires conventionnels, tels que les faibles profondeurs (<20 m), les récifs coralliens, les environnements polaires sous la glace ou encore les zones d’exclusion liées aux conflits. Leur navigation en immersion les rend indépendants des conditions de surface (houle, clapot), ce qui garantit une stabilité de trajectoire et une qualité de donnée constante, notamment pour les sonars à haute fréquence (>300 kHz) utilisés pour la cartographie haute résolution. De plus, la portée des AUVs, réduite par rapport à celle des navires de surface dans les zones profondes, permet d’obtenir une plus haute résolution des données, notamment les données bathymétriques. Le déploiement d’AUVs permet une réduction significative et hydrodynamique réduite, en limitant la dépendance aux navires océanographiques lourds et aux équipages spécialisés. Leur empreinte acoustique, thermique et hydrodynamique réduits minimise l’impact sur l’environnement marin, condition essentielle pour les relevés en zones protégées ou sensibles. Enfin, l’utilisation coopérative d’essaims d’AUVs autorise une couverture rapide de zones étendues, en multipliant les profils parallèles et en augmentant la densité spatiale des données acquises, ce qui améliore l’efficacité globale des campagnes.
9.Limites et défis technologiques
Les AUVs restent soumis à plusieurs contraintes technologiques majeures. L’autonomie énergétique constitue la principale limitation : en fonction du profil de mission, de la profondeur d’évolution et de la charge utile embarquée (MBES, SSS, SBP, CTD), l’endurance opérationnelle excède rarement quelques dizaines d’heures. Les communications acoustiques sous-marines, limitées par l’atténuation et la diffraction du signal dans le milieu, offrent une bande passante très restreinte (<1 kbit/s) et une latence importante, ce qui empêche la transmission en temps réel de volumes massifs de données bathymétriques ou sédimentologiques. Le risque de perte de vecteur demeure élevé dans les environnements complexes, tels que les canyons profonds, les champs d’épaves ou les cavités, où le positionnement relatif et la navigation inertielle peuvent dériver. Enfin, le coût d’acquisition initial d’un AUV équipé de capteurs hydrographiques avancés (MBES, SSS, SBP) atteint plusieurs millions d’euros par unité pour certains, bien que cet investissement puisse être compensé par la réduction des coûts de mobilisation des navires hydrographiques et par l’efficacité accrue des campagnes
10.Applications concrètes
Les AUVs sont aujourd’hui déployés dans un large spectre d’applications opérationnelles et scientifiques. Dans le domaine hydrographique, ils sont intégrés aux campagnes menées par les agences nationales telles que la NOAA, le SHOM ou l’UKHO, où ils complètent les levés multifaisceaux réalisés par navire en assurant une cartographie fine des zones peu accessibles. Dans le secteur offshore, ils constituent un outil de référence pour la prospection des ressources énergétiques et minérales (éolien en mer, hydrocarbures, nodules
polymétalliques), ainsi que pour l’inspection d’infrastructures sous-marine critiques telles que les pipelines, câbles de télécommunication et ouvrages portuaires. Sur le plan scientifique, les AUVs sont mobilisés pour des études de géologie marine, d’archéologie sous-marine ou
d’écologie benthique, grâce à leur capacité à collecter des données haute résolution dans des environnements sensibles. Leur rôle est également déterminant en contexte post-catastrophe (séismes, tsunamis, glissements sous-marins), où ils permettent une évaluation rapide et sécurisée des dommages sur les fonds marins et les infrastructures. Enfin, dans le domaine de la défense, les AUVs représentent un atout stratégique pour la guerre des mines et le renseignement géophysique, contribuant à la sécurisation des zones maritimes et à l’appui des opérations navales.
11.Perspectives d’avenir
Les évolutions attendues des AUVs concernent principalement l’endurance, l’autonomie décisionnelle et l’intéropérabilité.. L’augmentation de l’autonomie énergétique constitue un axe prioritaire : le recours à des batteries de nouvelle génération (Li-S, Li-air), à des piles à hydrogène ou à des systèmes hybrides (recharge par USVs ou stations sous-marines) permettra de prolonger significativement la durée des missions, au-delà des actuelles dizaines d’heures. L’intégration de capacités d’intelligence artificielle embarquée ouvre la voie à une navigation adaptative (évitage d’obstacles, replanification dynamique de mission) et à un traitement in situ des données acoustiques (classification automatique des fonds, détection d’objets anthropiques ou biologiques), réduisant la dépendance à la communication avec la surface.
Le développement de flottes coopératives d’AUVs, opérant en essaims synchronisés et intégrés avec des USVs et navires-mères, permettra d’augmenter la couverture spatiale et de densifier l’échantillonnage tout en optimisant les coûts logistiques. Parallèlement,
l’intéropérabilité logicielle et matérielle progresse via l’adoption de standards internationaux (OHI S-100, ISO, INSPIRE), assurant la compatibilité des données et facilitant leur intégration dans des infrastructures collaboratives telles que GEBCO ou EMODnet.
À long terme, ces avancées devraient aboutir à une hydrographie hautement automatisée, distribuée et interconnectée, dans laquelle les AUVs joueront un rôle central, en alimentant des systèmes globaux tels que le jumeau numérique des océans, outil stratégique pour la gestion durable, la recherche scientifique et la sécurité maritime.
12.Apport des micro-AUVs SEABER
Réduction des coûts et logistique simplifiée
La gamme de micro-AUVs développée par SEABER repose sur une architecture compacte et économique, permettant de réaliser des campagnes hydrographiques à un coût réduit, de l’ordre de 3 à 5 fois inférieur à celui des AUVs conventionnels.
Ces véhicules sont optimisés pour un déploiement à partir de n’importe quel moyen nautique (navire hydrographique, vedette, semi-rigide, kayak), ce qui supprime la dépendance aux navires océanographiques spécialisés et aux moyens de levage lourds. Ils peuvent également être déployés et récupérés depuis le rivage, ce qui simplifie les opérations dans des zones côtières ou des plans d’eau parfois difficiles d’accès pour les navires.
Avec une masse inférieure à 10kg et une longueur < 1 m, chaque micro-AUV est manipulable par un seul opérateur, réduisant significativement les contraintes logistiques, la taille des équipes et les coûts d’opération.
Les micro-AUVs de SEABER sont également faciles d’utilisation via le logiciel de programmation SEAPLAN, dédié au design des missions ainsi qu’à la maintenance du drone, et de la récupération des données. Une formation dispensée par SEABER suffit à développer la capacité de déployer un AUV et de l’utiliser pour la collecte de données.
Autonomie énergétique et endurance accrue
Les micro-AUVs SEABER disposent d’une autonomie nominale de 8 à 10 H, dépendant de la charge utile embarquée et permettent des missions cumulées atteignant jusqu’à 500 km de couverture.
Cette endurance surpasse les limitations traditionnelles des AUVs de plus petite taille, dont l’autonomie est souvent restreinte par la consommation énergétique des systèmes embarqués. L’architecture énergétique optimisée et le dimensionnement réduit des propulseurs permettent d’augmenter le ratio endurance/consommation, offrant une couverture spatio-temporelle élargie par unité logistique.
Navigation précise sans infrastructure externe
Les micro-AUVs intègrent le système de navigation inertielle INX, optionnellement couplé à un DVL (Doppler Velocity Logger), garantissant une précision de positionnement de l’ordre de 1 à 2% de la distance parcourue.
Ce niveau de performance est obtenu sans recourir à des systèmes de positionnement externe type USBL (Ultra-Short Baseline) ou LBL (Long Baseline), généralement coûteux et complexes à déployer. Cependant, un système USBL (Ultra-Short Baseline) équipe les micro- AUVs de la gamme MARVEL, leur conférant des capacités de positionnement accrues.
Cette capacité permet des missions précises dans des environnements où l’installation d’infrastructures acoustiques n’est pas envisageable (zones profondes, écosystèmes sensibles, opérations rapides).
Capacité de travailler en meute
L’architecture logicielle et matérielle des micro-AUVs est conçue pour un fonctionnement en flotte. Chaque drone possédant sa propre payload, ils peuvent être déployés en meute pour collecter des données de différentes nature ou pour démultiplier la capacité opérationnelle et de couverture spatiale des missions.
Le positionnement des drones MARVEL via l’unité de surface équipée du modem USBL permet de suivre jusqu’à 10 drones en même temps.
Cette approche de mutualisation des tâches augmente la robustesse de la mission (résilience face à une panne individuelle) et densifie l’échantillonnage spatial, optimisant l’efficacité des campagnes.
Modularité des capteurs embarqués
La gamme YUCO est conçue sur une plateforme commune et se décline en plusieurs versions spécialisées, chacune optimisée pour une mission ou un type de capteur :
YUCO-CTD : équipé d’une sonde CTD (Conductivity, Temperature, Depth) pour la caractérisation de la colonne d’eau et l’établissement de profils océanographiques.
YUCO-SCAN : intègre un sonar à balayage latéral (Side Scan Sonar) pour la cartographie des fonds marins, la détection d’objets et la caractérisation des habitats benthiques.
YUCO-PAM : configuré pour le Passive Acoustic Monitoring, destiné à l’acquisition de données acoustiques sous-marines (mammifères marins, activités anthropiques, ambiance sonore).
YUCO-PHYSICO : embarque des capteurs multiparamètres physico-chimiques (pH, oxygène dissous, turbidité, etc.) pour le suivi environnemental et la surveillance de la qualité de l’eau.
YUCO-CARRIER : version modulable servant de plateforme d’accueil pour des sondes ou capteurs externes personnalisés (magnétomètre, eDNA sampler, sondes chimiques, etc.).
YUCO-LUMEN équipé de systèmes d’imagerie optique et de photogrammétrie, permettant l’acquisition de données visuelles à haute résolution pour la cartographie 3D et l’étude des habitats marins.
Cette modularité permet une intégration rapide de charges utiles personnalisées (capteurs eDNA, magnétomètres, sondes phydisco-chimiques), tout en conservant une empreinte compacte et un temps de préparation réduit.
Conçue sur la même plateforme compacte que la YUCO, la gamme MARVEL cible prioritairement les secteurs sécurité, garde-côtes, missions de lutte contre les mines (MCM) et entraînement à la guerre anti sous-marine (ASW). Chaque version est optimisée pour une tâche spécifique, intégrant des capacités de positionnement acoustique (USBL), de communication, et des options telles que chiffrement des données ou auto-destruction (scuttling).
Spécifications communes :
Structure bi-compartimentée :
- Séction sèche (centre/arrières) étanche, non accessible à l’utilisateur — elle abrite la navigation (INX©), les batteries, les capteurs inertiels et l’électronique.
- Séction humide (avant) modulaire et utilisateur-accessible, avec connectivité plug- and-play pour diverses charges utiles.
Autonomie jusqu’à 10 heures, vitesse jusqu’à 6 noeuds, profondeur opérationnelle jusqu’à 300m, poids approximatif 10kg, longueur 1-1,3m.
Navigation avancée : système INX, DVL, positionnement et communication via un modem acoustique USBL (SeaTrac), interface SEAPLAN, récupération facilitée avec SEACOMM (localisation GPS, commandes de retour).
Voici les principales déclinaisons disponibles :
MARVEL-SCAN : équipé d’un sonar side-scan haute définition (fréquences multiples possibles), pour cartographie des fonds, identification d’objets, inspection d’habitats littoraux
MARVEL-MAGNETO : doté d’un magnétomètre fluxgate (Sensys), avec: portée tripartite XYZ à 100 Hz, résolution < 150 pT, linéarité < 20 ppm. Adapté à la détection d’anomalies magnétiques (épaves, objets métalliques, munitions sous-marines)
MARVEL-MBES : équipé d’un multibeam echo-sounder (MBES) — Imagenex 260 kHz (120 à 480 faisceaux, résolution ~0,02 % de la portée, taux jusqu’à 40 fps) — idéal pour la cartographie bathymétrique rapide et de haute résolution
MARVEL-3DS : version intégrant un sonar side-scan 3D (PingDSP 450kHz), fournissant des images de haute résolution avec couverture importante (jusqu’à 14× la profondeur), pour des relevés bathymétriques détaillés à partir de la conversion de données SSS en 3D
MARVEL-LUMEN : équipé d’une caméra sous-marine haute résolution avec éclairage LED,acquisition d’images fixes et vidéo géoréférencées. Cible la photogrammétrie, l’imagerie habitat ou la surveillance visuelle.
Acquisition multi-paramétrique et échantillonnage écologique
L’intégration simultanée de capteurs physico-chimiques, acoustiques et optiques permet une caractérisation exhaustive des habitats benthiques et de la colonne d’eau.
Les données acquises couvrent des paramètres variés : profils CTD, imagerie optique (photogrammétrie, vidéo), cartographie sonar, bathymétrie, magnétométrie, enregistrements acoustiques passifs, et échantillonnage indirect de biodiversité via la technologie eDNA.
Cette combinaison répond à la nécessité d’une approche, essentielle pour les études de biodiversité et la surveillance environnementale dans des contextes sensibles (aires marines protégées, sites d’exploitation offshore, infrastructures sous- marines).
Conclusion
L’hydrographie est au cœur des grands enjeux contemporains : sécurité maritime, exploitation durable des ressources, protection de l’environnement et défense. Grâce aux innovations technologiques et aux projets internationaux de cartographie, elle s’oriente vers une approche globale, collaborative et numérique. L’hydrographie de demain sera plus précise, accessible et interconnectée, contribuant à une meilleure compréhension et gestion des océans, patrimoine commun de l’humanité.
L’intégration des AUVs dans les missions hydrographiques constitue une avancée majeure vers des pratiques plus flexibles, précises et durables. Ils permettent une cartographie plus fine, une réduction des risques humains, et un accès facilité aux environnements difficiles. Les AUVs s’imposent donc comme des outils de choix pour répondre aux défis croissants liés à la connaissance, l’exploitation et la protection des milieux aquatiques.
L’hydrographie du futur sera autonome, collaborative et adaptative, avec les AUVs au cœur des systèmes d’observation marine.
Références
1. International Hydrographic Organization (IHO). (2020). Standards for Hydrographic Surveys, S-44.
2. NOAA Office of Coast Survey. (2024). Hydrographic Survey Operations Manual.
3. SHOM – Service Hydrographique et Océanographique de la Marine. (2023).
L’hydrographie moderne et ses outils.
4. Mayer, L. A., Jakobsson, M., & Allen, G. (2018). The Nippon Foundation—GEBCO Seabed 2030 Project: The Quest to See the World’s Oceans Completely Mapped by 2030. Geosciences, 8(2).
5. International Hydrographic Organization (IHO). Standards for Hydrographic Surveys. Publication S-44.
6. NOAA Office of Coast Survey. (2024). Hydrographic Survey Operations Manual.
7. Wynn, R. B., Huvenne, V. A. I., et al. (2014). Autonomous Underwater Vehicles (AUVs): Their role in modern oceanographic research. Marine Geology, 352, 451-468.
8. SHOM – Service Hydrographique et Océanographique de la Marine. (2023).
L’hydrographie moderne et ses outils.
9. Moline, M. A., et al. (2005). Remote environmental monitoring using autonomous underwater vehicles. Current Opinion in Biotechnology, 16(3), 229-234.
10. https://seaber.fr/large-scale-automated-mapping-with-micro-auvs-fleet.html
11. https://seaber.fr/making-auv-technology-accessible.html
https://seaber.fr/applications https://seaber.fr/yuco-auv-3dss
https://www.oceannews.com/news/science-technology/seaber-to-participate-in-mapping- and-characterization-of-biodiversity-with-micro-auvs
https://oceannews.com/news/subsea-and-survey/seaber-s-micro-auv-range-to-be- showcased-at-oceanology-international
https://www.oceansciencetechnology.com/news/micro-auv-fleet-to-be-mobilized-in-seamap- projecthttps://www.krkconsultantsltd.com/seaber-micro-auvs
https://bluezonegroup.com.au/product-catalogue/ras/auv/seaber-micro-auv/seaber-yuco- range/seaber-yuco-pam/
– Standards for Hydrographic Surveys,
S-44 (6th Edition)
https://iho.int/en/standards-and-specifications https://maritime-forum.ec.europa.eu